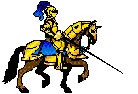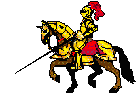voilà un debut de précision, prélevé chez "passeport santé"
(août 2006)...
L’ambérique et le dolique au fil du temps
L'origine du mot français « ambérique » reste obscure (« ambre »?), d'autant plus qu'il a aujourd'hui disparu de la majorité des dictionnaires. Pourtant, on continue de l'employer en France, tandis qu’au Canada, il apparaît dans des documents officiels du gouvernement.
Le terme « dolique » (XIVe siècle) vient du grec dolikos, qui veut dire « long », probablement par allusion à la longueur des gousses de certaines variétés.
Le genre Vigna comprend de nombreuses espèces, dont sept sont exploitées commercialement pour leurs grains. Elles sont originaires de l’Inde, de l’Extrême-Orient ou de l’Afrique de l’Ouest. De façon générale, nous en savons peu sur leur domestication, malgré le fait qu'elles aient constitué, et constituent encore, la base de l'alimentation pour des millions de personnes à travers le monde.
On sait, par exemple, que l’ambérique rouge (azuki) et l’ambérique vert (mungo) ont été introduits au Japon environ 1 000 ans avant notre ère, mais on ne connaît pas l'époque de leur domestication. En dehors du dolique, qui était déjà consommé en Europe au début de notre ère, les légumineuses du genre Vigna ont été introduites en Occident recemment, avec les vagues d'immigration en provenance de l'Asie et de l'Afrique. Par ailleurs, elles n'ont jamais joué un rôle important dans nos cultures, contrairement au riz et au soya, par exemple.
On en sait un peu plus sur le dolique, qui aurait été domestiqué il y a 5 000 ou 6 000 ans en Abyssinie (Éthiopie actuelle), en même temps que le sorgho, importante céréale de ce continent. Bien sûr, le dolique a été consommé à l'état sauvage bien longtemps avant sa domestication.
Le dolique mongette, une sous-espèce, a été introduit au début de notre ère par les Grecs de Marseille dans ce qui était encore la Gaule, d'où il s’est répandu progressivement dans le reste du pays. Son emploi reste très fréquent jusqu’à la Renaissance, bien que les textes médicaux du Moyen Âge l’accusent de provoquer « des songes terribles et mensongers ».
Après la conquête, il sera remplacé par le haricot du Nouveau Monde et sa culture ne survivra que dans de rares régions de France : Vendée, Poitou, Charentes. Il est toujours cultivé en Italie, en Espagne et tout particulièrement au Portugal. On le trouve aussi dans les pays arabes, et au Brésil, c'est l'une des principales légumineuses locales.
On pense qu'il a été introduit en Amérique par la Jamaïque, vers 1675, par les marchands d'esclaves noirs qui en apportaient de grandes quantités pour nourrir leur tragique cargaison. Comme il est bien adapté aux climats tropicaux et qu'il est riche en nutriments, il s'est rapidement diffusé aux Antilles. Au XVIIIe siècle, il y est cultivé partout. Après avoir fait son entrée aux États-Unis vers 1700, sa culture se répandra dans tous les États du Sud, remplaçant le pois, mal adapté aux températures élevées et aux sols secs. Aujourd’hui encore, il joue un rôle important dans l’alimentation des populations de ces contrées.""....
j'avais un document plus "medieval" qui faisait allusion à un haricot "oeil noir" que l'on melait à la cuisson avec une salade pour assurer un digestion plus facile...je m'en vais rechercher ce document...
on avance....pour la sauvegarde des monjettes dans nos chaudrons!!!